Pierre-Damien Huyghe
On trouvera ci-dessous les premiers éléments d’une conférence prononcée le 05 décembre 2023 à l’École Estienne sous le titre global « À double sens ». Il s’agissait de réfléchir aux enjeux d’une notion aujourd’hui souvent invoquée dans la société de consommation, celle d’acceptabilité.
La formulation d’énoncés à double sens est une capacité que les langues tolèrent. Parmi ces énoncés, il y a les ironiques qui, en principe, s’entendent de telle sorte qu’il n’y ait pas confusion. Le cynisme est plus ambigu. Le pire, du point de vue du destinataire, c’est la perversion. C’est « le pire » si du moins on se place dans une perspective morale telle que celle définie par Kant dans Un prétendu droit de mentir par l’humanité. Dans ce texte, Kant établit qu’on ne saurait fonder la vie sociale en faisant le moindre droit au mensonge. Mais qu’est-ce qu’un mensonge ? C’est une situation d’énonciation où le destinateur se débrouille pour que le destinataire ne puisse supposer quelque fausseté du côté de son énoncé. Dans les faits, qui réussit à mentir réussit à faire passer pour vrai ce qu’il dit. Cependant, si la possibilité de distinguer le vrai du faux n’est pas alors exercée, elle n’est pas pour autant suspendue. Elle l’est dans le cas de l’énoncé pervers. D’un tel énoncé, nous ne pouvons dire ni qu’il est vrai ni qu’il est faux. Il est à double sens, flottant dans sa signification.
Dan Graham prétendait que ses œuvres étaient ironiques en ce que, par exemple, quand on avait affaire à tel et tel de ses pavillons, on ne savait pas si l’on était à l’intérieur ou à l’extérieur. Cependant la différence demeurait, et même elle demeurait si bien que, justement, on pouvait se poser la question. Je prétends pour ma part qu’il existe maintenant auprès de nous des objets pervers, c’est-à-dire des objets dont nous ne savons pas dans quel sens ils fonctionnent. En principe une fonction, par exemple y=ax + b, associe à un élément (ici x) un autre et un seul autre (ici y) défini par la formule fonctionnelle ax + b. Nous avons coutume de définir de la sorte le service d’un objet instrumental. Ainsi disons-nous que la fonction d’un marteau, c’est de planter des clous, celle d’une automobile de nous transporter, etc. Les choses sont en réalité plus compliquées, car si nous étions plus précis et plus attentifs, nous devrions dire que le marteau et l’automobile, considérés du côté de leur fabrication, en aval pour ainsi dire de leur fonction d’usage, sont encore fonctionnellement liés à toute l’industrie sans laquelle ils n’existeraient pas pour nous servir comme ils nous servent. Le marteau est fonction de l’industrie métallurgique pour sa cognée, de celle du bois pour son manche. Quant à l’automobile, elle peut être définie comme une fonction terminale de l’industrie jusqu’à présent pétrolière, désormais électrique. Ce que je veux souligner, c’est que cette dualité fonctionnelle se manifeste matériellement dans l’allure même des objets concernés : elle prend forme dans cette allure. Il se voit que le marteau est une pièce fonctionnelle des industries du métal et du bois. De même la relation de l’automobile à la production pétrolière s’aperçoit dans le visible de l’objet qu’elle est : un réservoir jouxte le moteur, il est doté d’un bouchon sur la carrosserie et une jauge informe le conducteur de l’état de son remplissage.
Tel n’est pas le cas des objets technologiques mis au monde ces derniers temps. Ces objets sont complexes au sens propre du mot, c’est-à-dire faits d’un pli et d’un repli de la fonctionnalité en eux. Une fonction y joue sourdement au sein d’une série d’autres qui, elles, sont travaillées de façon à prendre allure. Il y a ici moins dualité fonctionnelle que duplicité fonctionnelle. C’est en quoi ils sont pervers. Il nous faudrait en outre nous intéresser à ce fait que leur mise en circulation est soutenue par une pratique elle-même perverse du langage. Ce que vise cette pratique, ce n’est pas à dire, mais à rendre acceptable ce qui est en jeu en retournant le sens de la situation. À titre d’exemples, « données » et « service » sont aujourd’hui des signifiants pervers, car retournables. Dans le service que me rend un terminal mobile et qui est réel (ce terminal est en effet bien pratique pour moi), ce que je fais sert à une fin qui non seulement n’apparaît pas, mais en outre est nommée « donnée » alors qu’il s’agit plus réellement d’une prise. Il y va d’un déplacement de la fonction descriptive ou constative du langage qui joue d’une propriété des langues, celle, précisément, de l’acceptabilité.
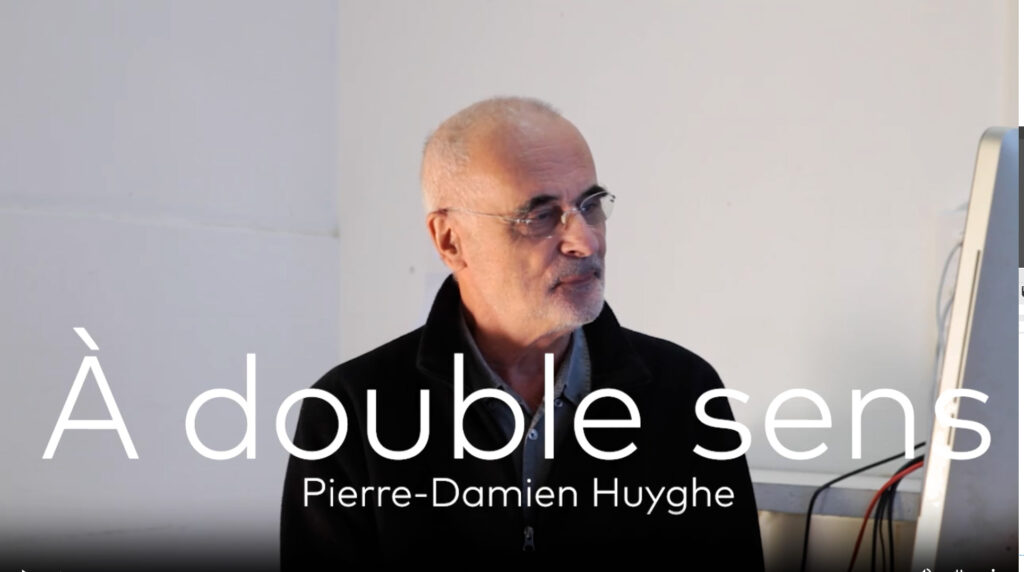

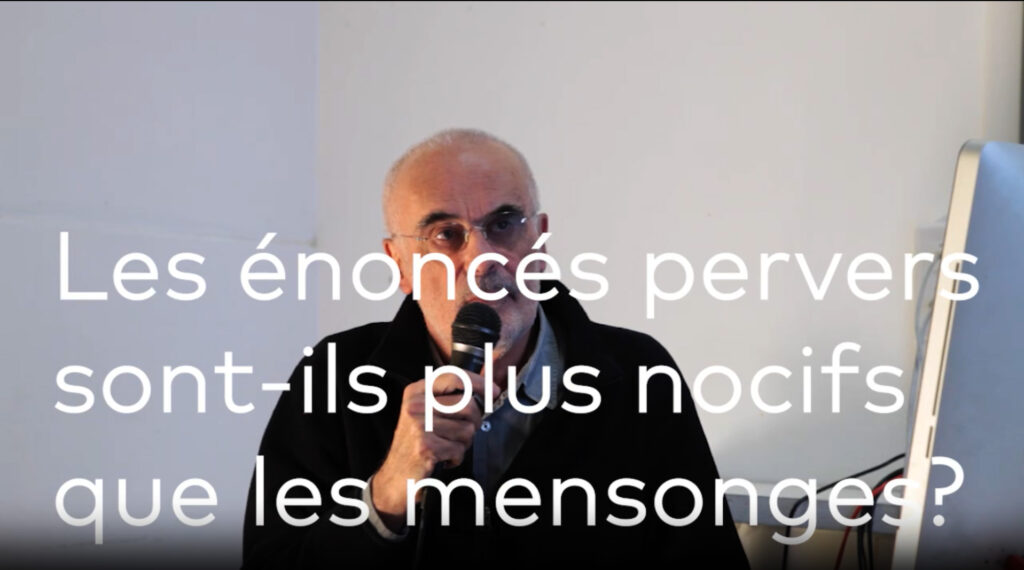

https://pleutin.fr/html_video/PierreDamienHuyghe_AdoubleSens_3_1_2024_Pleutin.html
Un film de Patrick Pleutin

